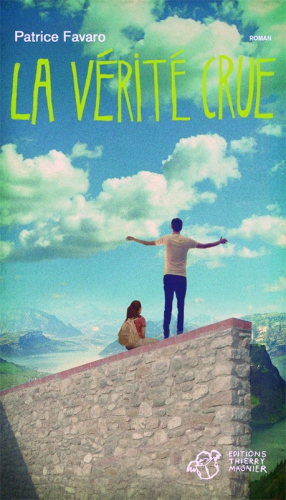Oui, resurgi du passé! Il y a quelques années, j'ai écrit, pour la manifestation Ecrire ensemble en Méditerranée, un texte où je faisais resurgir quelques personnages d'un passé tout personnel (réalité ou fiction). Cela devait donner lieu à une publication. Le temps a filé, l'oubli a recouvert tout cela de sa pelote. Et puis, samedi dernier, dans la boîte à lettres, le passé s'est fait présent pour redonner vie à ce texte dans un recueil qui rassemble des auteurs du Sud (Mireille Disdero, Régine Detambel, Marcus Malte, Jean-Luc Luciani et quelques autres) mais aussi les nouvelles primées des concours dont nous avons été les uns et les autres les parrains et marraines.

Dans ce texte, un de mes personnages fait prendre l'air aux mots.... une belle occasion de donner un peu d'air frais à ce récit en le mettant ici en ligne. En espérant que sa lecture vous donnera plaisir à cheminer en mes lignes.
SOUS UN HABIT D’ARLEQUIN
Tout territoire est une peau ou mieux un manteau sous le couvert duquel les hommes amassent leur pelote, tressent leur nid. Ils y naissent un jour, grandissent là pour la plupart et finissent par blanchir dans ce même espace balisé au quotidien, souvent sans jamais avoir ressenti l’envie de l’abandonner. C’est que tout territoire est un tissu à la maille étroite, un filet ; il enserre autant qu’il rassure. Difficile de s’en défaire sans éprouver la douleur d’une blessure.
Certains se sentent pourtant à l’étroit et trop engoncés dans cet habit-là. Si le plus grand nombre parvient à faire son miel entre les plis et les replis protecteurs de sa terre, d’autres étouffent vite sous le poids du coutil des habitudes. Ils aspirent à se frotter au grand dehors pour peu qu’ils l’aient entraperçu, ne serait-ce qu’une fois, un court instant, par un accroc fait à la trame des jours.
Longtemps j’ai porté un tel manteau sans en sentir le poids, un balandran de berger jeté entre les iscles d’or de la Durance et les torchères de la Shell. Un tissu d’Arlequin. Dix-sept pièces. De l’élégante et antique toile d’indienne aux fibres polymérisées de la pétrochimie. Dix-sept pièces cousues, de fil blanc, peut-être, mais bâties l’une sur l’autre au point de surjet avec l’espoir de durer. Des morceaux disparates, inventaire à la Prévert, des pièces assemblées au hasard de l’Histoire, des histoires, avec Sénas pour pôle Nord et Berre-l’Etang pour Croix du Sud.
Longtemps j’ai habité satisfait sous cet habit d’Arlequin, disais-je ; mais un matin, j’ai vu trois martinets zipper le ciel au-dessus de ma tête, en direction de l’est. Signe, augure, présage : brisé le charme qui me retenait prisonnier. J’ai salué ces oiseaux arpenteurs des nuées et l’envie m’a pris moi aussi de l’envol. Il ne faut jamais remettre ses rêves au lendemain. Sur la route de Lamanon, aux gelées de printemps, j’ai vu trop souvent des moutons emperlés de rosée scintiller aux rayons d’un soleil matinal qu’ils imaginent avec naïveté tout éternel. Des moutons qui portent un chiffre peint sur le dos, celui tracé de leur destin et de son terme : un éclair métallique et tranchant. Hommes ou bêtes, le temps nous est ainsi compté, il nous presse.
J’ai donc quitté mon toit, laissé Mallemort à son rocher et fait glisser le manteau de mes épaules.
Pour me sentir léger.
Et m’offrir au monde.
À présent, lorsqu’il m’arrive de revenir, c’est un habit de voyageur que j’ai sur le dos et le regard que je porte à ces lieux est désormais rincé du sédiment des habitudes. Ma curiosité s’y montre moins assoupie, mes sens plus aiguisés. Est-ce la raison pour laquelle, parmi le groupe de marcheurs que j’accompagnais ce jour là, moi seul ai remarqué le vieil homme assis sur un muret de pierres sèches ?
C’était à la mi-avril, l’hiver avait longtemps tenu sa proie ; à l’instant où il l’avait enfin lâchée, tout s’était mis à fleurir en désordre : thym et romarin, iris nains, cistes, asphodèles et euphorbes, les abricotiers et les cerisiers aussi dans les vergers tandis que sur les branches d’amandiers restaient encore des pétales. Une journée littéraire avait été organisée par les bibliothécaires de trois municipalités appartenant à la communauté de communes Agglopole Provence. Nous étions descendus de l’autobus aux confins de Pélissanne avec l’intention de rejoindre à pied Aurons et enfin Vernègues par un chemin qui court sur le crâne dégarni des collines. Ce n’était pas une expédition mais une balade propice à faire entendre un choix de textes tout autant qu’à inviter la quarantaine de participants à remplir les pages de leur carnet de vagabondage. Je devais ouvrir la marche, servir de guide au groupe, mais je ne tardai pas à me retrouver en queue de peloton, occupé que j’étais à marcher avec les mots, à les mâcher pour en faire des phrases.
Au-delà d’un plateau couturé de restanques stériles, balisé de pylônes T.H.T bourdonnant comme des insectes avant l’orage, le chemin glissait vers un vallon à travers un bois dense d’yeuses. De l’endroit précis où je me trouvais, j’apercevais plus bas dans la combe une oliveraie étroite suspendue à un surplomb de terre que retenait un muret. L’argenté des oliviers faisait clairière au mitan des chênes sombres ; des brassées de branches jonchaient le sol au pied de chaque arbre coiffé de frais. Le muret était bâti de pierres jaunes, il marquait la limite basse du champ, juste au-dessus du chemin. Un vieil homme avait choisi pour s’asseoir la plus large et la plus plate des pierres. Je vis la file des randonneurs qui me précédaient passer devant lui, aucun ne se soucia de sa présence, ce qui m’étonna fort. Je m’élançai à mon tour sur le chemin descendant. Allant bon pas pour tenter de rejoindre le groupe, j’entrai sous le couvert des chênes. La lumière y était plus incertaine, mouvante, liquide, une lumière de l’entre deux ; elle n’était déjà plus aussi rasante qu’en hiver mais ne ressemblait pas encore à celle de l’été, lorsqu’elle tombe du ciel comme un fil à plomb.
L’homme assis appartenait à l’espèce de ceux à qui on ne peut donner un âge parce qu’au-delà d’une certaine frontière les années se soudent les unes aux autres : impossible de les distinguer. Il ressemblait à ces vieillards qu’on voit arpenter les allées du marché avec un cabas qui ne se remplit jamais au bout du bras, un de ceux qui hantent les boulodromes, le foyer des anciens, le cercle républicain, les terrasses de café, avec une prédilection pour les plus étroites, coincées au ras de la rue. Là, sur leur chaise collée au mur, ils paraissent attendre des amis qui ne viendront plus.
Celui-là cachait son regard sous la visière d’une casquette. Sans doute se reposait-il là après une matinée de travail, la taille des oliviers me semblait achevée depuis peu.
Je l’ai salué, il m’a répondu d’un geste bref.
— C’est tardif, cette année, non ? ai-je demandé.
Il a marmonné à contrecœur quelques syllabes indistinctes. J’ai insisté, c’est des taiseux qu’on apprend le plus.
— Où trouve-t-on la meilleure ? Je parle de l’huile. Ici ? À La Fare-les-Oliviers, au moulin de Velaux, ou bien vaut-il mieux pousser de l’autre côté jusqu’à Eyguières ?
Cette fois, il a articulé avec soin :
— Caforna, anglada, faisso, chasalou, cabot...
— Je ne comprends pas ce que vous dites.
L’homme a tourné son visage vers moi. Des yeux bleus, sous la casquette.
— Je fais prendre l’air aux mots. Ceux-là ne sortent plus souvent maintenant. Rapparro, chambada, escamp, baou, granjon, clapas...
Quelques-uns avaient résonné dans mon enfance ; des mots pour dire le paysage que façonne l’homme, la terre qu’il retourne, les pierres qu’il dresse.
J’ai dit à mon tour :
— Il faudrait les noter pour ne pas les perdre. Les paroles s’envolent, les écrits restent.
J’ai sorti de mon sac un carnet et un crayon. L’homme s’est mis à rire.
— Ce ne sont pas des paroles qu’on met en conserve.
Il n’avait pas tort, j’ai rangé mon attirail. Les mots sont des organismes vivants, ils apparaissent, se répandent, puis un jour disparaissent faute d’usage. À quoi bon les empailler dans un lexique quand ils ne servent plus ? Pour que d’autres s’emparent de leur coquille vide et les folklorisent à des fins commerciales ? Le mas, l’oustau, le bastidon, lou toupin et lou cigalon, la jasse, et la magnanerie, les olivarelles : vestiges, des mots lyophilisés, maintenus artificiellement en vie. Les soins palliatifs sont inutiles, la langue ancienne est morte.
J’ai tourné le dos au gardien des mots pour m’avancer vers les oliviers. J’ai ramassé l’une des branches coupées. Dans ma main, le poids d’un souvenir lointain : le temps des Rameaux, le brin d’olivier lourdement chargé de sucettes et de sucres d’orge drapés dans du papier crissant.
Combien de temps ai-je suivi par la pensée mon chemin d’enfance, en cherchant à ramasser les petits cailloux qui j’y avais semés si longtemps auparavant ? Quand je me suis décidé à revenir enfin vers l’homme assis, il avait disparu. Qu’est-ce qui avait bien pu le faire s’envoler ainsi sans un bruit, sans un signe, sans un adieu ? N’était-ce qu’un fantôme surgi du passé ?
Je me suis assis un instant à l’endroit exact qu’il avait occupé.
La pierre était encore tiède.
Un froissement de feuilles. À l’orée du champ se tient à présent une femme, jeune encore et belle, les cheveux noués en un haut chignon retenu par un ruban. Elle porte une longue robe de forte toile, à plis serrés et fines rayures, sur laquelle est noué un tablier de coton blanc. Je devrais être surpris par cette soudaine apparition mais cette silhouette m’est étrangement familière.
J’examine plus attentivement ses traits.
—Je vous ai déjà vue.
Elle me sourit avec réserve.
—Oui, je vous ai vue dans un vieil album de photos. Vous posiez en arlésienne. Avec le grand costume : plastron, guimpe de dentelles et les deux fichus.
Je ne suis-je pas troublé par sa présence. Ce qui me la rend si naturelle ? J’ai un lien étroit de parentèle avec cette femme : nous avons le même goût pour noircir les pages d’un carnet.
— Je vous ai lue.
Elle hausse les sourcils.
— Votre journal, un journal de jeune fille, des cahiers bleus oubliés dans un grenier qu’il a fallu vider quand la maison de famille a changé de mains. Votre écriture si fine, à l’encre violette. 1886 pour commencer. Je me souviens de vos récits de promenade à La Barben ou Charleval. Au printemps, vous poussiez parfois jusqu’à Saint-Chamas sous un ciel endimanché.
Son visage rosit légèrement.
—Votre journal de l’année 1909, plus qu’aucun autre, est resté gravé dans ma mémoire. Le séisme du 11 juin, la terre qui s’ébroue tout le long de la faille de la Trévaresse. En pleine nuit. Les villages détruits de Rognes, de Vernègues, de Venelles, les maisons jetées bas de Lambesc, du Puy-Sainte-Réparade, de Salon de Provence. Vous étiez institutrice à Saint-Cannat en ce temps-là, dès les premières heures du jour vous avez rejoint les équipes de secours. Il y avait tant de plaies à panser...
Elle tend la main en direction du nord-est, vers le plateau.
— Des ouvriers italiens travaillaient à Vernègues quand la terre a tremblé. Il était neuf heures du soir.
C’est la première fois que j’entends sa voix. Les photos sont à jamais muettes dans les albums de famille.
— Ce sont eux les premiers qui ont couru, à demi vêtus dans la nuit naissante, à travers la colline jusqu’au village voisin d’Alleins pour demander de l’aide. Des étrangers, des Italiens.
— Pourquoi me parler d’eux ?
— Pour ne pas qu’on oublie, me dit-elle.
La jeune femme frissonne soudain. Une forte brise est venue secouer les branches alentour, elle porte avec elle un reste d’hiver ancien, la trace d’un de ces mauvais vents qui racornissent les pousses tendres, brûlent de leur haleine brune les feuillages nouveaux, les floraisons précoces. Après leur passage, les arbres ne donnent pas de fruits.
—C’était avant que la litanie des noms s’allonge sur la pierre grise des monuments aux morts plantés au cœur de chacun de nos villages.
Elle s’éloigne, muette à présent, elle s’efface. À l’autre bout de l’oliveraie, le silence, le creux dans la lumière qu’a laissé son absence.
Je me suis remis en chemin. Les marcheurs doivent être loin ; il s’en trouve toujours un, le plus obstiné, le moins rêveur, à vouloir imposer sa cadence parce que pressé de toucher au but. Mais quel but ?
Un bruit de cailloux qui roulent me tire de mes pensées. Un homme surgit au coude du chemin, la foulée vigoureuse, le visage hâlé de celui qui n’a jamais eu que le ciel au-dessus de sa tête pour travailler.
Il s’arrête devant moi pour essuyer d’un revers de main la sueur qui coule de son front. Une zébrure rouge traverse sa paume. Le trait d’une cicatrice encore vive.
Je lui demande :
— Vous vous êtes fait mal ?
— Oh, çà ? Ce n’est rien, nada, niente, walou... Souvenir de chantier.
Cette soupe de langues me pousse à le questionner davantage.
— Vous venez d’où ?
—Calabre, Andalousie, Kabylie ? Quelle importance ça peut bien avoir ? J’ai toujours été là qu’on a eu besoin de moi.
C’est vrai. Toujours présent pour poser les voies, bâtir les viaducs et percer les tunnels de la Côte bleue, présent pour creuser les darses du port de Fos, présent pour le sel, le ciment et la chaux, le bitume et l’asphalte, le pétrole et la chimie, présent pour tailler les vignes, récolter les fruits entre Alpilles et Durance. Présent, présent, trois fois présent.
Je l’interroge encore.
— Vous allez où ?
— J’aimerais rentrer chez moi maintenant.
— De quel côté habitez-vous ? Vers Rognac, Lançon ?
Il secoue la tête.
— Mais vous êtes d’ici ?
— Je l’ai longtemps cru, me dit-il. À présent, je me demande si je ne suis pas condamné à être de nulle part.
Il me montre le sud.
— Là-bas, au-delà de l’Étang de Berre, au bout du canal de Martigues : il y a la mer, je viens de là.
— D’où qu’on la contemple, la Méditerranée est toujours la Mare Nostrum. La même mer, la même mère, nous sommes de la même famille, non ?
L’étranger ne me répond rien. Il se remet en marche, d’un pas pressé, et disparaît derrière un bosquet de rouvres autour duquel s’arrondit le sentier.
Il a tourné le dos à mes utopies.
Plus loin. Plus tard.
Passé Aurons, sur le plateau ras et venteux avant de redescendre par une piste boisée jusqu’à Vernègues.
J’ai rejoint le groupe des marcheurs. Ils sont tous là : les habitués de la rando, les bibliothécaires, un trio d’adolescentes, l’homme en habit de broussard, quelques enfants, un solitaire. Arrêtés autour d’une large dalle de calcaire, blanche comme un os, marquée par deux sillons étroits et parallèles : la trace laissée par d’innombrables roues de charrettes, de charrois.
Quelqu’un s’interroge :
— Une voie romaine ?
Un autre :
— Combien faut-il de siècles pour creuser de pareilles ornières ?
Ce n’est qu’en passant qu’on laisse une marque, sans mouvement pas de trace, nulle ligne de vie, nulle ligne de force. C’est aussi sous le pas étranger que se forge un territoire.
La Via Aurelia et la Nationale 7.
Routes d’empires, où les conquérants croisent les vaincus.
La ruée des congés payés et la cicatrice du TGV.
Armée des ombres, Jean Moulin, zone libre, occupée, libérée et la Routes des vins.
Drailles, voies de toutes les transhumances, les exils, les exodes et pistes cyclables, trail, raid, éco-rando.
L’incessant mouvement brownien de ceux qui vont et qui viennent, de ceux qui s’en viennent et s’en vont. Entrelacs de pistes, sentes, parcours, routes. Il suffit d’ouvrir une brèche dans la terre d’ici pour que l’Histoire affleure aussitôt, qu’elle déborde.
Je laisse les marcheurs à leur examen des vestiges passés et m’avance vers l’un des enfants qui nous ont accompagnés. Demain m’importe davantage qu’hier. À l’écart du groupe, une feuille de papier à la main, il note quelque chose du bout de son crayon.
— Qu’est-ce que tu écris là ?
Pas de réponse.
— Je peux voir ?
Il me tend le feuillet avec assurance. Je lis à voix haute ce qu’il a écrit au milieu de la page, une phrase :
— J’ai vu de petits zèbres, jaunes et violets.
Je demande :
— Les iris nains qu’on a aperçus sur le chemin ?
Il me sourit, satisfait.
Tout territoire est un habit, ou mieux une peau qu’il faut sans cesse réinventer pour la tenir en vie.
Au retour, à l’étape, au logis, je vide ma besace sur le bois de la table. Alleins, Aurons, La Barben, Berre l’Étang, Charleval, Eyguières, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon de Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon de Provence, Sénas, Velaux, Vernègues. Dix-sept pièces. Je les ai comptées. Pas une ne manque à mon récit.
©Patrice Favaro
©Pour Agglopole Provence
Avril 2010.